L’UNIFA célèbre la dignité humaine dans une ambiance artistique et engagée
L’Université de la Fondation Dr Aristide a célébré la fête de la dignité, une activité d’envergure marquée par un message fort sur la valeur intrinsèque de la personne humaine, conjugué à des prestations artistiques variées qui ont tenu le public en haleine tout au long de la cérémonie.
Dans son discours d’ouverture, Mme Mildred Aristide a rappelé que la dignité humaine est une valeur fondamentale qui ne dépend ni des conditions sociales ni du regard d’autrui. « La dignité ne dépend ni de la richesse, ni du statut, ni du regard d’autrui. Elle naît avec l’être humain et l’accompagne jusqu’à son dernier soupir », a-t-elle souligné, appelant à une société fondée sur le respect, la justice et l’inclusion.
S’adressant particulièrement aux étudiants, Mme Aristide a insisté sur l’engagement de l’Université en faveur d’une éducation sans exclusion. « Chers Unifaristes, célébrer la dignité, c’est affirmer que chaque personne mérite respect, considération et justice. C’est refuser l’humiliation, le mépris, la violence et l’exclusion. Une éducation sans exclusion, voilà notre option à l’UNIFA », a-t-elle déclaré, avant d’adresser ses vœux pour l’année 2026.
Après cette intervention solennelle, la cérémonie a pris une tournure festive avec l’entrée en scène de l’orchestre de l’UNIFA. Les interprétations musicales ont mis l’ambiance à l’auditorium, rapidement gagnée par l’enthousiasme du public. Deux étudiants ont ensuite enflammé la salle, provoquant une vague de cris et d’applaudissements.
Le Club de l’Excellence a marqué l’un des temps forts de la journée avec la présentation d’un sketch intitulé « Divize pou donte », extrait du livre Haïti Haïtii (article 16). une performance à la fois engagée et appréciée, qui a porté l’ambiance à son apogée. Dans la même dynamique, une étudiante de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), accompagnée de la Chorale de l’UNIFA, a offert une prestation singulière, très applaudie par l’assistance.
La créativité estudiantine s’est poursuivie avec un hommage musical rendu à la sélection nationale de football pour ses performances lors des éliminatoires, un moment salué par une ovation prolongée. Une danse folklorique intitulée « Restitution », portée par plusieurs étudiants, a également retenu l’attention par la force de son message. Les prestations artistiques se sont ensuite enchaînées, allant de la musique à la danse, sous les ovations d’un public conquis.
Moment de reconnaissance et de fierté académique, l’Université de la Fondation Dr Aristide a profité de cette célébration pour honorer quatre anciens étudiants de la FSJP ayant brillamment réussi le concours d’admission à l’École de la Magistrature.
Mme Mildred Aristide a conclu la cérémonie en félicitant les étudiants pour leur engagement et leur créativité. Pour prolonger l’esprit de partage et d’espoir, elle a procédé à l’attribution, par tirage au sort, d’une bourse d’études par faculté, avec deux bourses accordées à la Faculté de Médecine, scellant ainsi une célébration placée sous le signe de la dignité, de l’excellence et de l’espoir.
À travers cette fête de la Dignité, l’Université de la Fondation Dr Aristide réaffirme sa vocation d’institution engagée, où la formation académique va de pair avec la promotion des valeurs humaines, de la justice sociale et de l’inclusion. En plaçant la dignité au cœur de son projet éducatif, elle confirme son rôle de creuset de citoyens responsables, conscients de leur valeur et appelés à contribuer activement à la transformation positive de la société haïtienne.









Cérémonie de prise de coiffe et d’habit
La Faculté des Sciences Infirmières de l’Université de la Fondation Dr Aristide a organisé, ce
jeudi 11 décembre, à l’auditorium du campus, la cérémonie officielle de prise de coiffe et d’habit
pour les 158 étudiants issus de la cohorte 2025-2026. Un moment solennel, marqué par des
messages forts de solidarité, de persévérance et d’engagement humanitaire.
C’est par une citation puissante du Président Jean-Bertrand Aristide – « Si l’un de nous souffre,
nous souffrons tous. Lè nen pran kou, je kouri dlo » – que la Directrice de la Faculté des Sciences
Infirmières, Miss Marjorie Gaussain, a ouvert l’événement. Un message choisi pour rappeler le
cœur de la profession. « A travers ces mots, nous avons la preuve que tous nous sommes
interconnectés, tous nous sommes solidaires », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Ici, à l’UNIFA,
nous formons des scientifiques, mais des scientifiques compatissants, combinant chez eux rigueur
scientifique et humanité. »
Après plusieurs mois d’initiation intensive depuis la rentrée académique 2025-2026, ces étudiants
ont franchi une étape cruciale de leur parcours. La Directrice a salué leur persévérance face aux
obstacles. Elle a détaillé le programme exigeant de cette première année, qui mêle biologie,
anatomie, physiologie, introduction à la pharmacologie, principes de soins, mais aussi
assainissement, chimie, communication et psychologie. « Ces enseignements leur permettront
d’être des professionnels qualifiés pour se mettre efficacement au service de leur communauté »,
a-t-elle précisé.
À l’approche de leur première entrée en milieu hospitalier, la Directrice les a exhortés à
poursuivre leurs efforts avec détermination. S’inspirant de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines,
elle leur a rappelé une devise de persévérance : « Chers étudiants, quotidiennement, chaque jour,
vous devez vous dire pour répéter l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, je veux et je peux. »
La cérémonie a également été ponctuée d’un moment d’histoire et d’hommage. Miss Darius
Morancy a présenté la biographie de Claire Heureuse Bonheur, première infirmière d’Haïti, dont
l’engagement humanitaire durant la période révolutionnaire demeure un modèle. Dévouée aux
malades, active même dans les conditions les plus difficiles, elle est reconnue comme une figure
majeure dans la valorisation de la profession infirmière dans le pays.
L’événement a culminé avec la traditionnelle prise de coiffe pour les étudiantes et la prise d’habit
pour les étudiants. Dans une atmosphère empreinte de joie, de fierté et d’espoir, les 158 futurs
professionnels ont symboliquement franchi une étape déterminante de leur formation. Parents,
proches et membres de l’institution ont salué une cérémonie marquante, porteuse d’engagement
et d’avenir.
Cette promotion, officiellement engagée sur la voie des soins, porte désormais la double
responsabilité de l’excellence scientifique et de l’indéfectible humanité, incarnant l’idéal de
solidarité et de service qui a marqué cette journée mémorable.




























Réhabilitation et handicap : l’UNIFA met en lumière un enjeu majeur pour Haïti
L’Université de la Fondation Dr Aristide a consacré son « jeudi de l’UNIFA » du 4 décembre 2025 à un sujet crucial : « L’importance de la réhabilitation dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap ». Deux spécialistes de haut niveau ont partagé leurs réflexions au cours de cette conférence. Il s’agit du Dr Handel Petit, Orthopédiste et Responsable l’Unité de Réhabilitation de l’Hôpital Universitaire Dr Aristide, et de Mme Thamar Michel, Physiothérapeute et Directrice de la Faculté des Sciences de Réhabilitation (FSR).
Le handicap, une réalité accentuée par les catastrophes
D’entrée de jeu, Mme Michel a rappelé que le handicap est considéré comme « toute limitation d’activités ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou encore d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Un phénomène loin d’être marginal : 15 % de la population mondiale vit avec une forme de handicap.
En Haïti, cette réalité a pris une ampleur dramatique depuis le séisme de 2010, qui a laissé derrière lui des milliers de blessés, de traumatismes et d’amputations. Aujourd’hui, les chiffres font état d’environ un million de personnes handicapées dans le pays. Le séisme du 14 août 2021 a aggravé la situation, ajoutant 54 000 nouveaux cas dans le Grand Sud.
La réhabilitation : un outil puissant pour restaurer l’autonomie
Pour Mme Michel, la réhabilitation n’est pas seulement un traitement : c’est un processus global visant à permettre à la personne handicapée ou blessée de retrouver un fonctionnement optimal. Qu’il s’agisse de restaurer des capacités, de prévenir des complications ou de ralentir une détérioration, l’objectif reste le même : remettre la personne au centre et lui redonner du pouvoir d’agir.
«La réhabilitation place la personne au centre et l’aide à développer pleinement son potentiel et à participer à la société. Elle a des effets non seulement sur les individus, mais aussi sur leurs familles, leurs communautés et sur leurs économies», a-t-elle souligné.
Physiothérapie : une discipline en plein essor en Haïti
La physiothérapie, définie comme l’art et la science du traitement par l’exercice, la chaleur, le massage ou encore l’électricité, s’est imposée comme un champ indispensable, surtout après 2010. Haïti compte aujourd’hui :l’Ecole de Physiothétapie de Léogâne et la Faculté des Sciences de Réhabilitation de l’UNIFA. Cette dernière totalise déjà sept promotions diplômées.
Chirurgie et réhabilitation : un duo indissociable
Prenant la parole, le Dr Handel Petit a rappelé que la prise en charge des fractures — qu’elles soient simples ou complexes — repose sur deux options : le traitement conservateur ou la chirurgie. Mais il a tenu à nuancer :«Une chirurgie réussie, c’est seulement 30 % du travail. Les 70 % restants dépendent de la physiothérapie».
Autrement dit, sans réhabilitation, un patient opéré ne retrouve pas sa fonctionnalité. D’où la nécessité d’une approche multidisciplinaire et d’un plan de réhabilitation personnalisé, élaboré conjointement par l’orthopédiste et le physiothérapeute.
Un message fort : investir dans la réhabilitation, c’est investir dans l’avenir
Cette édition du « jeudi de l’UNIFA » rappelle que la réhabilitation n’est pas un luxe, mais un besoin essentiel, particulièrement dans un pays où les catastrophes naturelles ont profondément marqué les corps et les vies. Orthopédistes et physiothérapeutes, plus que jamais, représentent un maillon vital pour aider les personnes en situation de handicap à retrouver autonomie, dignité et participation sociale.







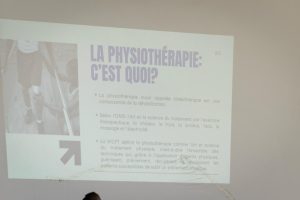


Programme d’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
AVIS
Tabarre le 04 décembre 2025
La Faculté des Sciences économiques et administratives (FSEA) de l’Université de la Fondation Dr Aristide (UNIFA) annonce le lancement du recrutement pour le programme d’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE.
Ce cursus, accessible aux titulaires du diplôme de fin d’études secondaires (Baccalauréat), s’étend sur trois ans.
Pièces exigées :
- Acte de naissance ou extrait des archives
- Deux photos d’identité,
- Diplôme de fin d’études secondaires (BAC),
- Carte d’identification nationale.
Pas de frais d’inscription.
NB : Pour de plus amples informations, appelez au : +509 2997-0406/ consultez : https://unifa-edu.info/contenu/assistante-administrative/
Deux plans d’action différents, une même ambition pour un campus plus propre
L’ambiance était électrique ce 27 novembre à l’Université de la Fondation Dr Aristide. Dans le cadre du « jeudi de l’UNIFA », la communauté universitaire s’est réunie autour d’un thème essentiel : « Mon campus, Ma responsabilité : Ensemble pour un campus propre et respectueux de l’environnement ». Deux équipes d’étudiants ont présenté leurs projets, donnant lieu à un véritable choc d’idées et à un débat des plus enrichissants.
La première équipe, composée de cinq étudiantes issues de différentes facultés, a présenté un plan d’action baptisé « UNIFA propre 2.0 ». Leur réflexion part d’un constat clair : Il faut maintenir le campus toujours propres… Voilà pourquoi, elles proposent l’installation de bacs à ordures de différentes couleurs, chacun ayant une fonction précise, accompagnés d’affiches explicatives.
Le bac jaune, appelé bac d’étude, serait placé dans les salles de cours pour  recueillir les déchets générés pendant les travaux pratiques. Le bac vert, destiné aux déchets organiques, serait installé à la cafétéria. Ces déchets serviraient ensuite à produire du compost, un engrais naturel pouvant enrichir la ferme agricole de l’Université. À terme, cela contribuerait à fournir des aliments plus sains à la communauté.Le bac gris, réservé aux déchets non recyclables, serait placé dans les toilettes pour la décharge finale.Le bac bleu, considéré comme le plus important, serait utilisé pour les déchets plastiques. Les plastiques collectés seraient vendus à des entreprises locales spécialisées dans la fabrication de bouteilles. L’argent récolté financerait l’accès gratuit à l’eau potable sur le campus.
recueillir les déchets générés pendant les travaux pratiques. Le bac vert, destiné aux déchets organiques, serait installé à la cafétéria. Ces déchets serviraient ensuite à produire du compost, un engrais naturel pouvant enrichir la ferme agricole de l’Université. À terme, cela contribuerait à fournir des aliments plus sains à la communauté.Le bac gris, réservé aux déchets non recyclables, serait placé dans les toilettes pour la décharge finale.Le bac bleu, considéré comme le plus important, serait utilisé pour les déchets plastiques. Les plastiques collectés seraient vendus à des entreprises locales spécialisées dans la fabrication de bouteilles. L’argent récolté financerait l’accès gratuit à l’eau potable sur le campus.
En face, le groupe des garçons a présenté un projet intitulé « Éco-Unifariste », centré sur la responsabilité individuelle et collective. Pour eux, un Éco-Unifariste est un étudiant qui s’engage activement à préserver la propreté de son environnement. Ils ont insisté sur la nécessité d’une sensibilisation continue afin d’encourager les comportements responsables.



Pour illustrer leur démarche, ils ont pris l’exemple du Rwanda: un pays autrefois confronté à des défis similaires en matière de salubrité, mais qui, grâce à l’implication citoyenne, est parvenu à faire de Kigali l’une des capitales les plus propres au monde. Inspirés par cet exemple, les garçons proposent la création de petites équipes au sein de chaque faculté pour surveiller et accompagner les étudiants dans l’adoption de meilleures pratiques.
Leur plan prévoit également l’aménagement de trois espaces spécialisés :
-
-
-
-
-
-
-
-
- un espace de compostage,
- un espace de recyclage,
- et un espace d’incinération des déchets.
-
-
-
-
-
-
-
Après les présentations, un riche échange a eu lieu. Les questions, nombreuses et pertinentes, ont permis d’approfondir les deux propositions. Ce jeudi de l’UNIFA s’est finalement révélé être un moment fort de réflexion collective, démontrant que la volonté de changement est bien présente chez les Unifaristes.


Jeudi de l’UNIFA : Une soutenance qui met en lumière les défis de l’effectivité de la déclaration de patrimoine en Haïti
Le jeudi de l’UNIFA du 20 novembre 2025 s’est distingué par une ambiance inhabituelle au sein de la communauté unifariste. Au cours de cette séance, l’Université la Fondation Dr Aristide a vibré au rythme d’une soutenance de mémoire qui a mis en lumière l’un des grands défis de la gouvernance haïtienne : la lutte contre la corruption. L’étudiant en Sciences juridiques, Salomon Charles, a présenté un travail percutant en vue de l’obtention du grade de Licencié en Sciences juridiques. Intitulée « Analyse de l’effectivité de la Loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics », sa recherche révèle un large fossé entre la volonté affichée par la loi et la réalité de son application, dressant le constat d’un outil essentiel paralysé par l’impunité.

Dès l’introduction, l’impétrant souligne la pertinence de son sujet : la déclaration de patrimoine, un outil essentiel de bonne gouvernance, demeure peu appliquée en Haïti. Alors que cette obligation vise à favoriser la transparence, prévenir l’enrichissement illicite et renforcer la confiance dans les institutions, elle se heurte à un sérieux problème d’effectivité.
Pour mieux comprendre ce décalage entre la norme et sa mise en œuvre, Salomon Charles a formulé une question centrale: Dans quelle mesure la loi du 12 février 2008 est-elle appliquée de manière effective en Haïti ? Son hypothèse principale avance que l’application partielle de cette loi, combinée au manque de sanctions effectives, compromet sérieusement son rôle dans la lutte contre la corruption.
Son travail vise à évaluer le niveau d’application de cet outil dans le contexte haïtien et poursuit trois objectifs spécifiques :
- évaluer le niveau réel de respect de la déclaration de patrimoine par les catégories concernées ;
- analyser les impacts liés à son application;
- examiner l’efficacité des sanctions et comparer les dispositifs haïtiens avec ceux de la France.
Pour étayer son analyse, l’étudiant s’est appuyé sur deux grandes théories : le positivisme juridique, selon lequel le droit doit être appliqué de manière objective et impersonnelle, et la théorie de la puissance publique, qui rappelle le devoir de l’État de faire respecter les normes, même face aux résistances individuelles. Ces deux cadres renforcent l’idée que l’État haïtien a non seulement le pouvoir, mais aussi l’obligation d’assurer l’application stricte de la déclaration de patrimoine et de sanctionner les manquements.
Sur le plan méthodologique, Salomon a combiné approche qualitative et quantitative. L’analyse documentaire lui a permis d’examiner les normes, rapports et textes pertinents, tandis que les données chiffrées fournies par l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) ont servi à mesurer le niveau de conformité. Cependant, il reconnaît plusieurs contraintes : manque d’accès aux acteurs institutionnels, absence de données récentes, et rareté des documents de déclaration de patrimoine, limitant ainsi certaines analyses plus poussées, notamment le croisement des informations.

Son mémoire est structuré en deux grandes parties: la première explore le cadre normatif et institutionnel entourant la déclaration de patrimoine en Haïti ; la seconde évalue l’application concrète de cette norme, avec une attention particulière aux sanctions prévues.
Les résultats sont sans équivoque :
- le non-respect de la loi est massif. Les chiffres disponibles révèlent un taux de conformité alarmant : seulement 9,8 % des personnes visées ont respecté la loi entre 2008 et 2022, laissant ainsi plus de 90 % des responsables publics en totale violation d’une obligation constitutionnelle, conventionnelle et légale.
- les sanctions sont inadaptées et rarement mises en œuvre ;
- en comparaison, la France mise davantage sur la force dissuasive des sanctions pénales, ce qui renforce l’application de l’obligation.
Pour remédier à cette situation, le jeune chercheur formule plusieurs recommandations : clarifier l’article 18 de la loi de 2008, particulièrement en lien avec l’éventuelle entrée en vigueur du nouveau code pénal ; appliquer réellement les sanctions existantes ; instaurer un système de sanctions graduées ; autoriser la publication des déclarations de patrimoine ; et établir un rapport annuel d’évaluation de cet outil.
En somme, ce mémoire met en lumière un enjeu crucial pour la gouvernance en Haïti : une loi, même bien conçue, demeure symbolique si elle n’est ni appliquée ni renforcée par des mécanismes de contrôle efficaces. Le travail de Salomon Charles apporte ainsi une contribution importante à la réflexion nationale sur la transparence et la lutte contre la corruption.

Jeudi de l’UNIFA : la FSEA met en lumière trois anciens diplômés
L’Université de la Fondation Dr Aristide a accueilli, ce13 novembre 2025, trois anciens étudiants de la Faculté des Sciences Économiques et Administratives (FSEA) dans le cadre de son activité hebdomadaire « jeudi de l’UNIFA ». Soraya Ketely Jean, Jonas Sébastien Félix Moncoeur et Darline Jean-Baptiste – aujourd’hui employés à l’Hôpital Universitaire Dr Aristide et à la Ferme agricole – sont venus partager leurs expériences, leurs défis et les leçons tirées de leur passage à l’université. Cette rencontre a offert à l’assistance un moment privilégié, riche en témoignages et en inspiration.

Soraya Ketely Jean: discipline et dignité comme clés de réussite
Première à intervenir, Soraya Ketely Jean, lauréate de la première promotion de la FSEA, est revenue sur son parcours académique et les raisons qui l’ont poussée à choisir les sciences administratives. Animée par l’ambition de devenir femme d’affaires, elle voyait dans l’administration « la ligne droite pour s’enrichir ».
Toutefois, ses années d’études lui ont révélé une vérité essentielle : la réussite durable ne repose pas d’abord sur l’argent, mais sur la discipline et la dignité. Elle a encouragé les étudiants présents à prendre leurs études au sérieux, rappelant que la rigueur et l’intégrité constituent les fondements de toute carrière solide.
Jonas Sébastien Félix Moncoeur: quatre années de formation pour bâtir une carrière solide
Deuxième intervenant, Jonas Sébastien Felix Moncoeur a souligné l’importance des quatre années qu’il a passées à la FSEA. Selon lui, cette formation lui a donné « l’essentiel » pour évoluer dans son domaine professionnel.
Employé à l’Hôpital Universitaire Dr Aristide, il a brièvement décrit ses responsabilités : accueil des patients, gestion de la caisse et diverses tâches. Son témoignage a permis aux étudiants de mieux comprendre les débouchés concrets offerts par la filière administrative.
Darline Jean-Baptiste: l’UNIFA comme famille et école de vie
De son côté, Darline Jean-Baptiste, aujourd’hui, employée à la Ferme agricole, a livré un témoignage empreint d’émotion. Le simple fait de revenir sur le campus a ravivé en elle les souvenirs de ses débuts, marqués à la fois par l’enthousiasme et le doute: allait-elle réussir ? Avait-elle fait le bon choix?
Avec du recul, elle affirme que l’Université de la Fondation Dr Aristide a profondément transformé sa vie. « Bien au-delà des cours et des notes, j’y ai trouvé une famille », a-t-elle confié. Elle a évoqué la communauté d’apprentissage et de solidarité qu’elle y a rencontrée, ainsi que les valeurs qui l’ont façonnée : rigueur, discipline, patience, respect et humilité.
Elle a rappelé qu’au moment de choisir la FSEA, elle n’imaginait pas l’ampleur des compétences qu’elle allait acquérir. Ses études lui ont appris à observer, planifier et persévérer, même lorsque les résultats tardaient à venir. Elle a conclu en invitant les étudiants à travailler avec détermination, discipline et constance.

Un moment d’inspiration pour la nouvelle génération
Cette édition du « jeudi de l’UNIFA » a permis de mettre en lumière la pertinence de la formation offerte par la Faculté des Sciences Economiques et Administratives et l’impact profond qu’elle a sur la trajectoire professionnelle et personnelle de ses diplômés.
À travers leurs récits, Soraya, Jonas et Darline ont rappelé aux étudiants que la réussite est un chemin fait d’efforts, de persévérance et de valeurs. Leur passage a renforcé la conviction que l’Université de la Fondation Dr Aristide ne forme pas seulement des professionnels, mais aussi des citoyens engagés, responsables et porteurs de changement.

Échange fructueux entre le Président de l’UNIFA, les représentants de classes et les membres du Club de l’Excellence
Le Président de l’Université de la Fondation Dr Aristide, Dr Jean-Bertrand Aristide, a rencontré, le vendredi 7 novembre 2025, les représentants de classes et les membres du Club de l’Excellence pour une séance de réflexion centrée sur l’éducation inclusive. Educare sine exclusione. L’échange a porté sur la nécessité, pour chaque étudiant, d’observer, de comprendre et de documenter la réalité de sa communauté.
Pour illustrer cette idée, le Président a introduit deux notions clés : l’« homunculus-cortical » et « l’organisation somatotopique du cerveau ». Il a souligné que le terme homunculus en latin signifie « petit homme ». L’adjectif « cortical », en revanche, est dérivé du mot « cortex ». Il a distingué cet usage scientifique de l’« homunculus » des alchimistes, qui, plusieurs siècles auparavant, tentaient d’imaginer la création d’un être humain artificiel. Ces deux concepts, bien que portant le même nom, renvoient à des réalités totalement différentes.
S’agissant de l’organisation somatotopique du cerveau, Dr Aristide a expliqué qu’elle correspond à la représentation des différentes parties du corps sur la surface corticale. En manipulant un modèle anatomique, il a rappelé que le cerveau est divisé en deux hémisphères et que toutes les parties du corps sont représentées sur la carte corticale. « Ce qu’il faut retenir, ce ne sont pas les détails, mais le pourcentage du corps représenté sur cette carte corticale. Par exemple, les mains occupent 20 à 25 % de la surface corticale », a-t-il indiqué, pour montrer la place disproportionnée accordée à certaines parties du corps.
Sur cette base, le fondateur de l’Université a proposé une analogie destinée à renforcer la vision éducative de l’institution. De même que chaque partie du corps est représentée dans le cerveau, chaque étudiant doit être capable de représenter dans sa pensée non seulement ses propres intérêts ou ceux de sa famille, mais aussi ceux de son quartier, de ses amis, de sa zone et de son pays. Cette perspective, a-t-il précisé, reflète les principes d’une éducation inclusive: développer son potentiel cognitif tout en restant ouvert à son environnement social. Educare sine exclusione. Selon lui, cette ouverture nourrit une intelligence citoyenne, capable d’observer, de comprendre et d’agir sur le réel.
Dans cette logique, le Président a insisté sur l’importance du formulaire distribué aux représentants de classe. Ce document permet d’identifier les infrastructures communautaires essentielles — services publics, établissements scolaires, structures sanitaires, entre autres — afin de mieux comprendre les conditions sociales, économiques et sanitaires propres à chaque localité. En collectant ces informations, chaque étudiant contribue à une cartographie actualisée du territoire et à un renforcement des liens entre savoir, solidarité et engagement communautaire.
Cette rencontre a ainsi permis de mettre en évidence la mission centrale de l’Université de la Fondation Dr Aristide: former des citoyens conscients, responsables et impliqués dans l’amélioration de leur environnement.

Réflexion autour des pensées du Dr Jean-Bertrand Aristide et du Dr Jean Price Mars
Le « jeudi de l’UNIFA » du 30 octobre 2025 a pris une dimension particulière, marquant une nouvelle fois la vitalité intellectuelle et le sens critique qui caractérisent l’Université de la Fondation Dr Aristide. Cette édition a réuni les représentants des différentes facultés autour d’un exercice d’analyse portant sur deux citations emblématiques du Dr Jean-Bertrand Aristide, Président de l’Université, et du Dr Jean Price Mars, figure majeure de la pensée haïtienne.
« Pour contribuer à guérir notre pays souffrant d’une négligence spatiale unilatérale, les élites ne doivent être ni des anosognosiques politiques ni des analphabètes politiques », a affirmé le Dr Aristide. Quant au Dr Jean Price Mars, il déclarait : « La classe dirigeante se désintéresse du sort des masses. » Ces deux réflexions, issues d’époques différentes, ont servi de point de départ à un dialogue intergénérationnel autour des responsabilités des élites et de la nécessité d’un engagement citoyen et collectif pour transformer la société haïtienne.
Un jury composé de Me Joselaine Mangnan, Doyenne de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, présidente, Me Blanchard Jean-Baptiste et Me Joseph Ducasse (membres) avait pour mission d’évaluer les interventions des étudiants et de sélectionner les trois meilleures prestations. Chaque participant disposait de cinq minutes pour présenter son analyse, établir les liens entre les deux citations et questionner les similitudes de pensée entre les deux auteurs.
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a ouvert la séance avec une intervention alliant profondeur analytique et appel à l’action. La Faculté des Sciences de Réhabilitation a proposé une lecture critique des deux pensées, tandis que la représentante de la Faculté des Sciences de la Nature et de l’Agriculture (FSNA) a su démontrer, avec clarté et conviction, les points de convergence et de divergence entre les deux auteurs, tout en invitant à une prise de conscience collective pour un changement radical du pays.
La représentante de la Faculté des Sciences Infirmières a mis en lumière l’unité de vision entre les deux penseurs, soulignant qu’ils partagent un même constat sur la condition des masses tout en se distinguant par certaines nuances d’approche. Les représentants des autres facultés ont, à leur tour, déployé tous les efforts nécessaires pour captiver l’auditoire, proposant des analyses alliant la profondeur des citations des auteurs à une réflexion lucide sur la situation actuelle du pays. La compétition pour la première place fut particulièrement serrée : les interventions, chacune plus éloquente que la précédente, ont su séduire le public, qui n’a cessé d’applaudir avec enthousiasme à l’issue de chaque prestation.
Après délibération, le jury a décerné le premier prix à la représentante de la FSNA, Kaïla François, saluant la pertinence et la cohérence de son intervention. Rose Sterling Marcellus, la représentante de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a remporté la deuxième place. Suivie de la Faculté des Sciences Infirmières, classée troisième, représentée par Lois-Shama Catherine Marcellus.
Ce « jeudi de l’UNIFA » a une fois de plus mis en évidence la mission éducative et citoyenne de l’Université de la Fondation Dr Aristide : former des esprits critiques, conscients de leur rôle dans la construction d’une société plus juste, solidaire et équitable.















Jeudi de l’UNIFA : retour sur l’impact dévastateur de la Peste Porcine Africaine en Haïti
L’Université de la Fondation Dr Aristide a accueilli, ce 23 octobre, dans le cadre du « jeudi de l’UNIFA », l’Agronome Roger Rosen Jasmin. À travers une conférence sur « L’impact de la Peste Porcine Africaine (PPA) au début des années 80 sur l’élevage porcin en Haïti », il a invité l’assistance à une réflexion approfondie sur l’avenir de cette filière dans le pays.
Au cours de son intervention, l’agronome Jasmin a d’abord présenté la nature et les caractéristiques de la maladie. Selon lui, la Peste Porcine Africaine est une maladie virale hautement contagieuse qui touche aussi bien les porcs domestiques que sauvages, quel que soit leur âge. Elle entraîne des pertes économiques considérables et représente une menace sanitaire majeure pour les pays touchés.
Très résistante, la PPA se propage rapidement, favorisée par les échanges commerciaux internationaux et les mouvements d’animaux et de produits dérivés.
Une maladie redoutable et difficile à contrôler
L’agronome a expliqué que le virus responsable de la PPA, un virus à ADN du genre Asfivirus appartenant à la famille des Asfarviridae, peut rester viable pendant de longues années dans le sang. La transmission s’effectue soit par contact direct entre animaux sains et malades, soit par voie indirecte, notamment à travers les objets contaminés, la nourriture ou le transport d’animaux infectés.
Parmi les symptômes les plus fréquents, il a cité la forte fièvre, les hémorragies cutanées et internes, ainsi qu’un taux de mortalité particulièrement élevé. La période d’incubation varie entre cinq et dix jours. Dans sa forme chronique, la maladie provoque perte de poids, nécroses cutanées, ulcères et raideur articulaire, évoluant lentement sur plusieurs mois.
Un coup dur pour le monde rural haïtien
Revenant sur la situation avant l’épidémie, l’agronome Jasmin a rappelé qu’avant 1978, Haïti comptait plus d’un million de porcs, et près de 80 à 90 % des ménages ruraux en possédaient au moins un. Véritable « banque sur pattes », le porc représentait un pilier économique et social pour les familles paysannes.
Un porc acheté 50 gourdes pouvait être revendu entre 300 et 750 gourdes après engraissement, permettant aux paysans de faire face aux imprévus, de payer les frais scolaires ou même d’acquérir des terrains.
L’entrée de la maladie et la réponse de l’État
L’orateur a ensuite retracé l’historique de l’introduction de la PPA en Haïti. Découverte en République Dominicaine en juillet 1978, la maladie a rapidement inquiété les autorités haïtiennes. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) mit alors en place un cordon sanitaire le long de la frontière, allant de la baie de Manseline à Anse-à-Pitres.
Dans cette zone tampon de 15 km, plus de 21 000 porcs appartenant à près de 8 000 éleveurs furent abattus en trois mois, dans une tentative d’empêcher la propagation du virus. Malgré ces mesures drastiques, la maladie finit par se propager sur tout le territoire.
Le programme PEPPA/DEP et ses limites
Face à l’ampleur de la crise, l’État haïtien sollicita l’aide internationale pour éradiquer la maladie, donnant naissance au Programme d’Éradication de la Peste Porcine Africaine / Développement de l’Élevage Porcin (PEPPA/DEP).
Si le programme permit effectivement de supprimer la PPA, il eut des conséquences socio-économiques dramatiques. Le processus d’éradication s’accompagna d’une destruction totale du cheptel porcin haïtien, sans qu’un véritable programme de repeuplement ne soit mis en œuvre, contrairement à la République Dominicaine, où la filière porcine put être relancée.
Un héritage toujours douloureux
En conclusion, l’agronome Jasmin a souligné que cette période a marqué un tournant tragique pour la paysannerie haïtienne. La disparition du porc créole – parfaitement adapté aux conditions locales – a profondément désorganisé les systèmes agricoles et affaibli la résilience économique des ménages ruraux.
Cette présentation a offert aux participants un éclairage historique précieux sur une page sombre de l’agriculture haïtienne et sur la nécessité de politiques agricoles durables et adaptées aux réalités locales.






















