Jeudi de l’UNIFA
Jeudi de l’UNIFA
Intelligence Artificielle : un appel à l’esprit critique
L’Université de la Fondation Dr Aristide a accueilli ce 15 janvier, dans le cadre du « jeudi de l’UNIFA », le Doyen de la Faculté de Génie et d’Architecture, l’Ingénieur Evens Toussaint, autour du thème de l’Intelligence Artificielle (IA).


Il s’agit de la troisième intervention du spécialiste en « base de données et intégration de système » sur ce sujet d’actualité. Cette fois-ci, son message a été clair : les étudiants doivent prendre du recul et développer un esprit critique face à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle.
Pour rendre accessible le fonctionnement de l’IA, l’Ingénieur Toussaint a illustré son propos à partir d’un modèle mathématique simple basé sur la prédiction. Il a expliqué qu’une droite est définie par une équation, par exemple y = 2x + 1. Lorsque la valeur de x est connue, celle de y peut être déterminée. De même, lorsque plusieurs points sont connus, ils forment un nuage de points à partir duquel un modèle peut être construit afin de prédire des valeurs.
« Au départ, on trace une droite quelconque, c’est-à-dire qu’on attribue des valeurs aux paramètres a et b. Ensuite, un algorithme teste différentes valeurs de ces paramètres afin d’ajuster la droite au nuage de points et de minimiser les erreurs », a-t-il expliqué. Cette démarche, selon lui, illustre la logique fondamentale qui sous-tend le fonctionnement des modèles d’intelligence artificielle.
Au-delà des aspects techniques, le Doyen a exhorté les étudiants à ne pas se limiter à un rôle de simples utilisateurs des outils d’IA, mais à chercher à comprendre les mécanismes internes et la dynamique qui les gouvernent.


L’Ingénieur civil a également abordé la question des fonctionnalités émergentes de l’IA. Il a cité l’exemple d’un modèle entraîné à traduire le français vers l’anglais, et l’anglais vers l’espagnol. À la surprise des concepteurs, le modèle s’est montré capable de traduire directement du français vers l’espagnol, bien qu’il n’ait pas été explicitement entraîné pour cette tâche. Cette capacité dite « émergente » alimente aujourd’hui certaines inquiétudes quant aux limites futures de l’intelligence artificielle.
En conclusion, le Doyen de la Faculté de Génie et d’Architecture a insisté sur la nécessité, pour les étudiants, de toujours vérifier les informations et les réponses fournies par l’IA. Développer un esprit critique demeure, selon lui, indispensable pour une utilisation responsable de ces technologies. Il a enfin appelé à une adaptation des programmes de formation, afin que l’université ne devienne pas « un musée du savoir oublié », mais reste en phase avec les évolutions technologiques contemporaines.
À travers cette conférence, l’Université de la Fondation Dr Aristide confirme son engagement à offrir à ses étudiants une formation ancrée dans les réalités contemporaines et ouverte aux grandes mutations technologiques. En donnant la parole à des cadres académiques de haut niveau et en encourageant une réflexion critique sur des enjeux majeurs comme l’intelligence artificielle, elle confirme sa volonté de former non seulement des professionnels compétents, mais aussi des citoyens capables de penser, d’analyser et d’agir de manière responsable dans un monde en constante évolution.



Cérémonie de prise de coiffe et d’habit
La Faculté des Sciences Infirmières de l’Université de la Fondation Dr Aristide a organisé, ce
jeudi 11 décembre, à l’auditorium du campus, la cérémonie officielle de prise de coiffe et d’habit
pour les 158 étudiants issus de la cohorte 2025-2026. Un moment solennel, marqué par des
messages forts de solidarité, de persévérance et d’engagement humanitaire.
C’est par une citation puissante du Président Jean-Bertrand Aristide – « Si l’un de nous souffre,
nous souffrons tous. Lè nen pran kou, je kouri dlo » – que la Directrice de la Faculté des Sciences
Infirmières, Miss Marjorie Gaussain, a ouvert l’événement. Un message choisi pour rappeler le
cœur de la profession. « A travers ces mots, nous avons la preuve que tous nous sommes
interconnectés, tous nous sommes solidaires », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : « Ici, à l’UNIFA,
nous formons des scientifiques, mais des scientifiques compatissants, combinant chez eux rigueur
scientifique et humanité. »
Après plusieurs mois d’initiation intensive depuis la rentrée académique 2025-2026, ces étudiants
ont franchi une étape cruciale de leur parcours. La Directrice a salué leur persévérance face aux
obstacles. Elle a détaillé le programme exigeant de cette première année, qui mêle biologie,
anatomie, physiologie, introduction à la pharmacologie, principes de soins, mais aussi
assainissement, chimie, communication et psychologie. « Ces enseignements leur permettront
d’être des professionnels qualifiés pour se mettre efficacement au service de leur communauté »,
a-t-elle précisé.
À l’approche de leur première entrée en milieu hospitalier, la Directrice les a exhortés à
poursuivre leurs efforts avec détermination. S’inspirant de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines,
elle leur a rappelé une devise de persévérance : « Chers étudiants, quotidiennement, chaque jour,
vous devez vous dire pour répéter l’Empereur Jean-Jacques Dessalines, je veux et je peux. »
La cérémonie a également été ponctuée d’un moment d’histoire et d’hommage. Miss Darius
Morancy a présenté la biographie de Claire Heureuse Bonheur, première infirmière d’Haïti, dont
l’engagement humanitaire durant la période révolutionnaire demeure un modèle. Dévouée aux
malades, active même dans les conditions les plus difficiles, elle est reconnue comme une figure
majeure dans la valorisation de la profession infirmière dans le pays.
L’événement a culminé avec la traditionnelle prise de coiffe pour les étudiantes et la prise d’habit
pour les étudiants. Dans une atmosphère empreinte de joie, de fierté et d’espoir, les 158 futurs
professionnels ont symboliquement franchi une étape déterminante de leur formation. Parents,
proches et membres de l’institution ont salué une cérémonie marquante, porteuse d’engagement
et d’avenir.
Cette promotion, officiellement engagée sur la voie des soins, porte désormais la double
responsabilité de l’excellence scientifique et de l’indéfectible humanité, incarnant l’idéal de
solidarité et de service qui a marqué cette journée mémorable.




























Réhabilitation et handicap : l’UNIFA met en lumière un enjeu majeur pour Haïti
L’Université de la Fondation Dr Aristide a consacré son « jeudi de l’UNIFA » du 4 décembre 2025 à un sujet crucial : « L’importance de la réhabilitation dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap ». Deux spécialistes de haut niveau ont partagé leurs réflexions au cours de cette conférence. Il s’agit du Dr Handel Petit, Orthopédiste et Responsable l’Unité de Réhabilitation de l’Hôpital Universitaire Dr Aristide, et de Mme Thamar Michel, Physiothérapeute et Directrice de la Faculté des Sciences de Réhabilitation (FSR).
Le handicap, une réalité accentuée par les catastrophes
D’entrée de jeu, Mme Michel a rappelé que le handicap est considéré comme « toute limitation d’activités ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou encore d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Un phénomène loin d’être marginal : 15 % de la population mondiale vit avec une forme de handicap.
En Haïti, cette réalité a pris une ampleur dramatique depuis le séisme de 2010, qui a laissé derrière lui des milliers de blessés, de traumatismes et d’amputations. Aujourd’hui, les chiffres font état d’environ un million de personnes handicapées dans le pays. Le séisme du 14 août 2021 a aggravé la situation, ajoutant 54 000 nouveaux cas dans le Grand Sud.
La réhabilitation : un outil puissant pour restaurer l’autonomie
Pour Mme Michel, la réhabilitation n’est pas seulement un traitement : c’est un processus global visant à permettre à la personne handicapée ou blessée de retrouver un fonctionnement optimal. Qu’il s’agisse de restaurer des capacités, de prévenir des complications ou de ralentir une détérioration, l’objectif reste le même : remettre la personne au centre et lui redonner du pouvoir d’agir.
«La réhabilitation place la personne au centre et l’aide à développer pleinement son potentiel et à participer à la société. Elle a des effets non seulement sur les individus, mais aussi sur leurs familles, leurs communautés et sur leurs économies», a-t-elle souligné.
Physiothérapie : une discipline en plein essor en Haïti
La physiothérapie, définie comme l’art et la science du traitement par l’exercice, la chaleur, le massage ou encore l’électricité, s’est imposée comme un champ indispensable, surtout après 2010. Haïti compte aujourd’hui :l’Ecole de Physiothétapie de Léogâne et la Faculté des Sciences de Réhabilitation de l’UNIFA. Cette dernière totalise déjà sept promotions diplômées.
Chirurgie et réhabilitation : un duo indissociable
Prenant la parole, le Dr Handel Petit a rappelé que la prise en charge des fractures — qu’elles soient simples ou complexes — repose sur deux options : le traitement conservateur ou la chirurgie. Mais il a tenu à nuancer :«Une chirurgie réussie, c’est seulement 30 % du travail. Les 70 % restants dépendent de la physiothérapie».
Autrement dit, sans réhabilitation, un patient opéré ne retrouve pas sa fonctionnalité. D’où la nécessité d’une approche multidisciplinaire et d’un plan de réhabilitation personnalisé, élaboré conjointement par l’orthopédiste et le physiothérapeute.
Un message fort : investir dans la réhabilitation, c’est investir dans l’avenir
Cette édition du « jeudi de l’UNIFA » rappelle que la réhabilitation n’est pas un luxe, mais un besoin essentiel, particulièrement dans un pays où les catastrophes naturelles ont profondément marqué les corps et les vies. Orthopédistes et physiothérapeutes, plus que jamais, représentent un maillon vital pour aider les personnes en situation de handicap à retrouver autonomie, dignité et participation sociale.







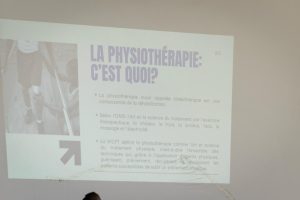


Deux plans d’action différents, une même ambition pour un campus plus propre
L’ambiance était électrique ce 27 novembre à l’Université de la Fondation Dr Aristide. Dans le cadre du « jeudi de l’UNIFA », la communauté universitaire s’est réunie autour d’un thème essentiel : « Mon campus, Ma responsabilité : Ensemble pour un campus propre et respectueux de l’environnement ». Deux équipes d’étudiants ont présenté leurs projets, donnant lieu à un véritable choc d’idées et à un débat des plus enrichissants.
La première équipe, composée de cinq étudiantes issues de différentes facultés, a présenté un plan d’action baptisé « UNIFA propre 2.0 ». Leur réflexion part d’un constat clair : Il faut maintenir le campus toujours propres… Voilà pourquoi, elles proposent l’installation de bacs à ordures de différentes couleurs, chacun ayant une fonction précise, accompagnés d’affiches explicatives.
Le bac jaune, appelé bac d’étude, serait placé dans les salles de cours pour  recueillir les déchets générés pendant les travaux pratiques. Le bac vert, destiné aux déchets organiques, serait installé à la cafétéria. Ces déchets serviraient ensuite à produire du compost, un engrais naturel pouvant enrichir la ferme agricole de l’Université. À terme, cela contribuerait à fournir des aliments plus sains à la communauté.Le bac gris, réservé aux déchets non recyclables, serait placé dans les toilettes pour la décharge finale.Le bac bleu, considéré comme le plus important, serait utilisé pour les déchets plastiques. Les plastiques collectés seraient vendus à des entreprises locales spécialisées dans la fabrication de bouteilles. L’argent récolté financerait l’accès gratuit à l’eau potable sur le campus.
recueillir les déchets générés pendant les travaux pratiques. Le bac vert, destiné aux déchets organiques, serait installé à la cafétéria. Ces déchets serviraient ensuite à produire du compost, un engrais naturel pouvant enrichir la ferme agricole de l’Université. À terme, cela contribuerait à fournir des aliments plus sains à la communauté.Le bac gris, réservé aux déchets non recyclables, serait placé dans les toilettes pour la décharge finale.Le bac bleu, considéré comme le plus important, serait utilisé pour les déchets plastiques. Les plastiques collectés seraient vendus à des entreprises locales spécialisées dans la fabrication de bouteilles. L’argent récolté financerait l’accès gratuit à l’eau potable sur le campus.
En face, le groupe des garçons a présenté un projet intitulé « Éco-Unifariste », centré sur la responsabilité individuelle et collective. Pour eux, un Éco-Unifariste est un étudiant qui s’engage activement à préserver la propreté de son environnement. Ils ont insisté sur la nécessité d’une sensibilisation continue afin d’encourager les comportements responsables.



Pour illustrer leur démarche, ils ont pris l’exemple du Rwanda: un pays autrefois confronté à des défis similaires en matière de salubrité, mais qui, grâce à l’implication citoyenne, est parvenu à faire de Kigali l’une des capitales les plus propres au monde. Inspirés par cet exemple, les garçons proposent la création de petites équipes au sein de chaque faculté pour surveiller et accompagner les étudiants dans l’adoption de meilleures pratiques.
Leur plan prévoit également l’aménagement de trois espaces spécialisés :
-
-
-
-
-
-
-
-
- un espace de compostage,
- un espace de recyclage,
- et un espace d’incinération des déchets.
-
-
-
-
-
-
-
Après les présentations, un riche échange a eu lieu. Les questions, nombreuses et pertinentes, ont permis d’approfondir les deux propositions. Ce jeudi de l’UNIFA s’est finalement révélé être un moment fort de réflexion collective, démontrant que la volonté de changement est bien présente chez les Unifaristes.


Jeudi de l’UNIFA : la FSEA met en lumière trois anciens diplômés
L’Université de la Fondation Dr Aristide a accueilli, ce13 novembre 2025, trois anciens étudiants de la Faculté des Sciences Économiques et Administratives (FSEA) dans le cadre de son activité hebdomadaire « jeudi de l’UNIFA ». Soraya Ketely Jean, Jonas Sébastien Félix Moncoeur et Darline Jean-Baptiste – aujourd’hui employés à l’Hôpital Universitaire Dr Aristide et à la Ferme agricole – sont venus partager leurs expériences, leurs défis et les leçons tirées de leur passage à l’université. Cette rencontre a offert à l’assistance un moment privilégié, riche en témoignages et en inspiration.

Soraya Ketely Jean: discipline et dignité comme clés de réussite
Première à intervenir, Soraya Ketely Jean, lauréate de la première promotion de la FSEA, est revenue sur son parcours académique et les raisons qui l’ont poussée à choisir les sciences administratives. Animée par l’ambition de devenir femme d’affaires, elle voyait dans l’administration « la ligne droite pour s’enrichir ».
Toutefois, ses années d’études lui ont révélé une vérité essentielle : la réussite durable ne repose pas d’abord sur l’argent, mais sur la discipline et la dignité. Elle a encouragé les étudiants présents à prendre leurs études au sérieux, rappelant que la rigueur et l’intégrité constituent les fondements de toute carrière solide.
Jonas Sébastien Félix Moncoeur: quatre années de formation pour bâtir une carrière solide
Deuxième intervenant, Jonas Sébastien Felix Moncoeur a souligné l’importance des quatre années qu’il a passées à la FSEA. Selon lui, cette formation lui a donné « l’essentiel » pour évoluer dans son domaine professionnel.
Employé à l’Hôpital Universitaire Dr Aristide, il a brièvement décrit ses responsabilités : accueil des patients, gestion de la caisse et diverses tâches. Son témoignage a permis aux étudiants de mieux comprendre les débouchés concrets offerts par la filière administrative.
Darline Jean-Baptiste: l’UNIFA comme famille et école de vie
De son côté, Darline Jean-Baptiste, aujourd’hui, employée à la Ferme agricole, a livré un témoignage empreint d’émotion. Le simple fait de revenir sur le campus a ravivé en elle les souvenirs de ses débuts, marqués à la fois par l’enthousiasme et le doute: allait-elle réussir ? Avait-elle fait le bon choix?
Avec du recul, elle affirme que l’Université de la Fondation Dr Aristide a profondément transformé sa vie. « Bien au-delà des cours et des notes, j’y ai trouvé une famille », a-t-elle confié. Elle a évoqué la communauté d’apprentissage et de solidarité qu’elle y a rencontrée, ainsi que les valeurs qui l’ont façonnée : rigueur, discipline, patience, respect et humilité.
Elle a rappelé qu’au moment de choisir la FSEA, elle n’imaginait pas l’ampleur des compétences qu’elle allait acquérir. Ses études lui ont appris à observer, planifier et persévérer, même lorsque les résultats tardaient à venir. Elle a conclu en invitant les étudiants à travailler avec détermination, discipline et constance.

Un moment d’inspiration pour la nouvelle génération
Cette édition du « jeudi de l’UNIFA » a permis de mettre en lumière la pertinence de la formation offerte par la Faculté des Sciences Economiques et Administratives et l’impact profond qu’elle a sur la trajectoire professionnelle et personnelle de ses diplômés.
À travers leurs récits, Soraya, Jonas et Darline ont rappelé aux étudiants que la réussite est un chemin fait d’efforts, de persévérance et de valeurs. Leur passage a renforcé la conviction que l’Université de la Fondation Dr Aristide ne forme pas seulement des professionnels, mais aussi des citoyens engagés, responsables et porteurs de changement.

Réflexion autour des pensées du Dr Jean-Bertrand Aristide et du Dr Jean Price Mars
Le « jeudi de l’UNIFA » du 30 octobre 2025 a pris une dimension particulière, marquant une nouvelle fois la vitalité intellectuelle et le sens critique qui caractérisent l’Université de la Fondation Dr Aristide. Cette édition a réuni les représentants des différentes facultés autour d’un exercice d’analyse portant sur deux citations emblématiques du Dr Jean-Bertrand Aristide, Président de l’Université, et du Dr Jean Price Mars, figure majeure de la pensée haïtienne.
« Pour contribuer à guérir notre pays souffrant d’une négligence spatiale unilatérale, les élites ne doivent être ni des anosognosiques politiques ni des analphabètes politiques », a affirmé le Dr Aristide. Quant au Dr Jean Price Mars, il déclarait : « La classe dirigeante se désintéresse du sort des masses. » Ces deux réflexions, issues d’époques différentes, ont servi de point de départ à un dialogue intergénérationnel autour des responsabilités des élites et de la nécessité d’un engagement citoyen et collectif pour transformer la société haïtienne.
Un jury composé de Me Joselaine Mangnan, Doyenne de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, présidente, Me Blanchard Jean-Baptiste et Me Joseph Ducasse (membres) avait pour mission d’évaluer les interventions des étudiants et de sélectionner les trois meilleures prestations. Chaque participant disposait de cinq minutes pour présenter son analyse, établir les liens entre les deux citations et questionner les similitudes de pensée entre les deux auteurs.
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a ouvert la séance avec une intervention alliant profondeur analytique et appel à l’action. La Faculté des Sciences de Réhabilitation a proposé une lecture critique des deux pensées, tandis que la représentante de la Faculté des Sciences de la Nature et de l’Agriculture (FSNA) a su démontrer, avec clarté et conviction, les points de convergence et de divergence entre les deux auteurs, tout en invitant à une prise de conscience collective pour un changement radical du pays.
La représentante de la Faculté des Sciences Infirmières a mis en lumière l’unité de vision entre les deux penseurs, soulignant qu’ils partagent un même constat sur la condition des masses tout en se distinguant par certaines nuances d’approche. Les représentants des autres facultés ont, à leur tour, déployé tous les efforts nécessaires pour captiver l’auditoire, proposant des analyses alliant la profondeur des citations des auteurs à une réflexion lucide sur la situation actuelle du pays. La compétition pour la première place fut particulièrement serrée : les interventions, chacune plus éloquente que la précédente, ont su séduire le public, qui n’a cessé d’applaudir avec enthousiasme à l’issue de chaque prestation.
Après délibération, le jury a décerné le premier prix à la représentante de la FSNA, Kaïla François, saluant la pertinence et la cohérence de son intervention. Rose Sterling Marcellus, la représentante de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques a remporté la deuxième place. Suivie de la Faculté des Sciences Infirmières, classée troisième, représentée par Lois-Shama Catherine Marcellus.
Ce « jeudi de l’UNIFA » a une fois de plus mis en évidence la mission éducative et citoyenne de l’Université de la Fondation Dr Aristide : former des esprits critiques, conscients de leur rôle dans la construction d’une société plus juste, solidaire et équitable.















Jeudi de l’UNIFA : retour sur l’impact dévastateur de la Peste Porcine Africaine en Haïti
L’Université de la Fondation Dr Aristide a accueilli, ce 23 octobre, dans le cadre du « jeudi de l’UNIFA », l’Agronome Roger Rosen Jasmin. À travers une conférence sur « L’impact de la Peste Porcine Africaine (PPA) au début des années 80 sur l’élevage porcin en Haïti », il a invité l’assistance à une réflexion approfondie sur l’avenir de cette filière dans le pays.
Au cours de son intervention, l’agronome Jasmin a d’abord présenté la nature et les caractéristiques de la maladie. Selon lui, la Peste Porcine Africaine est une maladie virale hautement contagieuse qui touche aussi bien les porcs domestiques que sauvages, quel que soit leur âge. Elle entraîne des pertes économiques considérables et représente une menace sanitaire majeure pour les pays touchés.
Très résistante, la PPA se propage rapidement, favorisée par les échanges commerciaux internationaux et les mouvements d’animaux et de produits dérivés.
Une maladie redoutable et difficile à contrôler
L’agronome a expliqué que le virus responsable de la PPA, un virus à ADN du genre Asfivirus appartenant à la famille des Asfarviridae, peut rester viable pendant de longues années dans le sang. La transmission s’effectue soit par contact direct entre animaux sains et malades, soit par voie indirecte, notamment à travers les objets contaminés, la nourriture ou le transport d’animaux infectés.
Parmi les symptômes les plus fréquents, il a cité la forte fièvre, les hémorragies cutanées et internes, ainsi qu’un taux de mortalité particulièrement élevé. La période d’incubation varie entre cinq et dix jours. Dans sa forme chronique, la maladie provoque perte de poids, nécroses cutanées, ulcères et raideur articulaire, évoluant lentement sur plusieurs mois.
Un coup dur pour le monde rural haïtien
Revenant sur la situation avant l’épidémie, l’agronome Jasmin a rappelé qu’avant 1978, Haïti comptait plus d’un million de porcs, et près de 80 à 90 % des ménages ruraux en possédaient au moins un. Véritable « banque sur pattes », le porc représentait un pilier économique et social pour les familles paysannes.
Un porc acheté 50 gourdes pouvait être revendu entre 300 et 750 gourdes après engraissement, permettant aux paysans de faire face aux imprévus, de payer les frais scolaires ou même d’acquérir des terrains.
L’entrée de la maladie et la réponse de l’État
L’orateur a ensuite retracé l’historique de l’introduction de la PPA en Haïti. Découverte en République Dominicaine en juillet 1978, la maladie a rapidement inquiété les autorités haïtiennes. Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) mit alors en place un cordon sanitaire le long de la frontière, allant de la baie de Manseline à Anse-à-Pitres.
Dans cette zone tampon de 15 km, plus de 21 000 porcs appartenant à près de 8 000 éleveurs furent abattus en trois mois, dans une tentative d’empêcher la propagation du virus. Malgré ces mesures drastiques, la maladie finit par se propager sur tout le territoire.
Le programme PEPPA/DEP et ses limites
Face à l’ampleur de la crise, l’État haïtien sollicita l’aide internationale pour éradiquer la maladie, donnant naissance au Programme d’Éradication de la Peste Porcine Africaine / Développement de l’Élevage Porcin (PEPPA/DEP).
Si le programme permit effectivement de supprimer la PPA, il eut des conséquences socio-économiques dramatiques. Le processus d’éradication s’accompagna d’une destruction totale du cheptel porcin haïtien, sans qu’un véritable programme de repeuplement ne soit mis en œuvre, contrairement à la République Dominicaine, où la filière porcine put être relancée.
Un héritage toujours douloureux
En conclusion, l’agronome Jasmin a souligné que cette période a marqué un tournant tragique pour la paysannerie haïtienne. La disparition du porc créole – parfaitement adapté aux conditions locales – a profondément désorganisé les systèmes agricoles et affaibli la résilience économique des ménages ruraux.
Cette présentation a offert aux participants un éclairage historique précieux sur une page sombre de l’agriculture haïtienne et sur la nécessité de politiques agricoles durables et adaptées aux réalités locales.
















Quatorzième année des « jeudi de l’UNIFA »
La restauration solidaire au cœur des échanges
C’est dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse que s’est déroulée, ce 9 octobre, la première édition du « jeudi de l’UNIFA » pour l’année académique 2025-2026. Tenu à l’auditorium du campus, l’événement a réuni étudiants, professeurs et membres de l’administration autour d’un programme riche en émotions et en réflexions.
La cérémonie s’est ouverte sur une prestation remarquable de l’Orchestre de l’UNIFA, dont les interprétations vibrantes ont captivé l’assistance. L’auditorium, conquis, a salué la performance par de longs applaudissements.
Prenant la parole, Mme Mildred Aristide a exprimé sa joie de souhaiter la bienvenue aux étudiants au nom d’elle-même et du Président de l’Université, le Dr Jean-Bertrand Aristide. Dans son allocution, elle a rappelé les trois piliers fondamentaux de l’institution : l’enseignement, la recherche et le service à la communauté.
Elle a profité de l’occasion pour annoncer un projet phare qui incarne ces trois dimensions: la restauration solidaire. Selon elle, cette initiative dépasse largement le cadre d’un simple service de cafétéria. « Bien plus qu’un simple service de cafeteria, cet espace sera un lieu privilégié d’apprentissage collectif, de recherche appliquée, et de service à notre communauté universitaire, et bien sûr à la communauté haïtienne », a-t-elle souligné. Mme Aristide a précisé que ce projet s’inscrit dans une vision globale que le Président Aristide résume par cette formule : « de la terre à l’assiette et de l’assiette à la santé »
Dans son intervention, le Responsable des Affaires Académiques, Dr Dodley Sévère, a procédé à l’ouverture officielle de l’année académique. Il a mis en avant l’importance des « jeudi de l’UNIFA » dans la formation des étudiants, précisant qu’ils constituent un espace complémentaire d’apprentissage et de réflexion, consacré à des thématiques non abordées dans le cursus de formation. Il a également rappelé que ces conférences feront l’objet d’une évaluation en fin d’année.
La rencontre a ensuite pris une tournure plus festive avec une nouvelle série de morceaux interprétés par l’Orchestre, ravivant une fois de plus la salle. L’enthousiasme de l’assistance témoignait de la vitalité et du dynamisme qui caractérisent la vie universitaire à l’Université de la Fondation Dr Aristide.
Profitant de cette ambiance conviviale, Madame Menos a rappelé aux étudiants les règles essentielles concernant la scolarité, tandis que la Doyenne de la Faculté de Médecine, Dr Daphnée Benoît Delsoin, a détaillé la philosophie et les bénéfices du projet de restauration solidaire. Elle a expliqué que les produits utilisés proviennent directement de la ferme agricole de l’Université, gérée par des agronomes formés au sein même de l’institution.
Selon elle, cette initiative offre trois avantages majeurs aux étudiants : une alimentation saine grâce à des produits locaux et naturels, une contribution citoyenne à la santé collective, et enfin, un accès facilité aux services médicaux de l’Hôpital Universitaire Dr Aristide.
La cérémonie s’est achevée sur cette note d’espoir et de solidarité, laissant présager une année académique 2025-2026 prometteuses, placée sous le signe du savoir, de la responsabilité sociale et de la santé pour tous.



.






















Les étudiants de l’Université de la Fondation Dr Aristide découvrent les richesses de leur ferme agricole
L’Université de la Fondation Dr Aristide a une fois de plus démontré son engagement envers la relance économique, le développement agricole et l’innovation dans l’enseignement supérieur. Ce jeudi 12 décembre, sur la place Dignité, la Faculté des Sciences Économiques et Administratives (FSEA) et la Faculté des Sciences de la Nature et de l’Agriculture (FSNA) ont présenté au public les produits phares de la Ferme Agricole de l’Université, avec un accent particulier sur la production de poulets de chair.
Dans une ambiance conviviale, étudiants, professeurs et invités ont découvert les fruits d’une initiative innovante, mêlant théorie et pratique. Le doyen de la FSNA, l’ingénieur-agronome Arlan Lecorps, a profité de l’occasion pour détailler les nombreuses activités menées à la ferme, parmi lesquelles figurent l’élevage de poulets et de lapins, la production d’œufs, les cultures maraîchères (notamment tomates, calalou et autres légumes variés), ainsi que la plantation de bananes. Selon lui, une gestion rigoureuse et efficace est mise en place pour assurer la qualité des productions.
Le succès de ce domaine agricole repose également sur l’implication active des étudiants. Certains passent jusqu’à quinze nuits consécutives sur place pour surveiller des paramètres cruciaux, tels que la température dans les cages des poulets. Cette immersion pratique permet aux futurs ingénieurs-agronomes d’acquérir des compétences essentielles en gestion et en production agricoles.
L’ingénieur-agronome Jean Bosco Ducasse, doyen par intérim de la Faculté des Sciences Economiques et Administratives, a salué ce projet qu’il qualifie de « révolutionnaire » pour l’enseignement supérieur en Haïti. L’initiative articule les activités académiques de deux facultés, offrant aux étudiants une formation complète et intégrée. À la FSEA, les étudiants de troisième année se plongent dans des tâches pratiques telles que la gestion des stocks, le marketing et la distribution, renforçant ainsi leur compréhension des rouages économiques et financiers de la ferme.
Au-delà de l’aspect pédagogique, la Ferme Agricole de l’Université répond à des enjeux nationaux. Avec des poulets prêts en 45 jours et atteignant un poids idéal 5,5 livres, la production est conçue pour satisfaire une demande locale croissante, notamment
en période de fin d’année. Deux options sont proposées au public : des poulets sur pattes ou déjà abattus, le tout à des prix compétitifs.
Ces poulets organiques, fruit d’une gestion exemplaire, incarnent la double mission de l’exploitation : soutenir la recherche académique tout en contribuant à la relance agricole. « C’est une manière efficace de répondre aux besoins des Unifaristes et du public en général », a affirmé M. Ducasse.
En mettant en avant ses capacités de production, l’Université de la Fondation Dr Aristide illustre son rôle clé dans le développement durable et l’autosuffisance alimentaire en Haïti. Ce projet, soutenu par une vision novatrice, témoigne d’une volonté de transformer les défis en opportunités, plaçant ainsi l’université à l’avant-garde de l’enseignement supérieur et de l’agriculture durable dans le pays.





















Commémoration, à l’UNIFA, du quatorzième anniversaire du séisme du 12 janvier 2010
La communauté de l’Université de la Fondation Dr Aristide s’est réunie avec émotion à la « Place Dignité », ce 11 janvier, pour commémorer les quatorze ans du séisme de 2010. Organisé chaque année par l’UNIFA, cet événement est une occasion pour les proches des disparus de la grande famille unifariste de se recueillir et de se souvenir.

La cérémonie a démarré à 11 heures par une traditionnelle marche pleine de solennité. Celle-ci a débuté à l’auditorium et s’est dirigée vers la Place Dignité. Des étudiants portant des ballons gonflables blancs et des bougies allumées ont guidé la procession.
 Sur la Place Dignité, les participants ont formé un cercle, déposant des bougies sur une table recouverte d’un tissu blanc, en signe de respect. Le Révérend Père Wesner Nérée, Responsable de discipline à l’Université de la Fondation Dr Aristide, a ouvert la cérémonie avec des mots empreints de réflexion et de mémoire.
Sur la Place Dignité, les participants ont formé un cercle, déposant des bougies sur une table recouverte d’un tissu blanc, en signe de respect. Le Révérend Père Wesner Nérée, Responsable de discipline à l’Université de la Fondation Dr Aristide, a ouvert la cérémonie avec des mots empreints de réflexion et de mémoire.
« 2010-2024, cela fait quatorze ans déjà depuis qu’un tremblement de terre ravageur qui n’a duré que 35 secondes avait frappé notre pays à travers les départements de l’Ouest et du Sud-Est. En effet, il a fallu 35 secondes pour que nous enregistrions plus de deux cent cinquante mille personnes tuées ou portées disparues. Il a fallu 35 secondes pour assister à l’effondrement de bâtiments et locaux symbolisant l’Etat, le monde religieux, le monde politique, éducatif, hospitalier et j’en passe », a rappelé le prêtre.



« A la veille de cette date qui ne doit pas être oublié, la grande famille de l’UNIFA se rassemble sur cette place pour un exercice et un devoir de mémoire. Exercice de mémoire pour nous souvenir et rendre hommage à toutes les victimes de ce séisme : nos parents, nos amis, nos collègues, nos confrères, nos collaborateurs, nos collaboratrices, mais aussi celles et ceux dont nous ignorions leur existence », a-t-il ajouté.
Le Responsable de discipline a également souligné l’importance de l’exercice de mémoire pour rester vigilant face aux catastrophes naturelles qui menacent Haïti. « Un exercice et un devoir de mémoire pour nous inciter à la vigilance et nous aider à prendre conscience et nous sensibiliser davantage au comportement à adopter pour réduire au maximum les conséquences ou limiter les dégâts dans l’éventualité d’autres catastrophes naturelles, puisque notre pays est traversé de plusieurs failles sismiques et placé sous la trajectoire des cyclones, tempêtes et ouragans. »
réduire au maximum les conséquences ou limiter les dégâts dans l’éventualité d’autres catastrophes naturelles, puisque notre pays est traversé de plusieurs failles sismiques et placé sous la trajectoire des cyclones, tempêtes et ouragans. »
Père Nérée a, par la suite, cité les noms de proches de l’Université de la Fondation Dr Aristide qui ont été victimes du séisme. À chaque nom, un ballon a été lâché. Et, à la fin de la commémoration, des étudiants ont relâché des colombes. « Les colombes de couleur blanche symbolisent la pureté de nos rêves », précisa-t-il.
Cette cérémonie de commémoration à l’UNIFA n’est pas seulement une occasion de se souvenir du passé douloureux, mais aussi un appel à l’action pour construire un avenir plus fort et résilient.




